Tasty. Ricardo. Les Chefs. Toutes-les-émissions-où-Gordon-Ramsay-engeule-du-monde. Un souper presque parfait. L’épicerie. La semaine verte. Instagram. Vegan. Une-recette-de-muffin-qui-a-l’air-cochonne-mais-oh-wow-c’est-fait-avec-des-zucchinis-et-des-graines-de-lin-finalement. Obésité. Orthorexie. Le nouveau resto du coin. Le plus nouveau plus cool plus hip resto du Mile End.
Choix alimentaires ostentatoires – motivés par l’exotisme, l’esthétisme et le spectacle, encadrés par les médias sociaux et de masse.
D’autres, liés à des sous-cultures alimentaires prisées par leurs adeptes, contre vents et marées.
Choix de sucre, de gras et de sel, de facilité et du quotidien, influencés par des considérations macroéconomiques et capitalistes de moindre coût pour le plus grand profit. Ce, aux dépens de notre santé personnelle et publique. Nous n’avons jamais autant entendu parler d’épidémie d’obésité, alors qu’encore une partie trop importante de la population souffre d’insécurité alimentaire, même ici, au Canada.
Nos signaux de satiété sont complètement défectueux.
C’est infernal, c’est infini. Manger, penser à manger, faire des listes d’ingrédients, saliver, dépenser des centaines de dollars – la nourriture et l’alimentation sont omniprésentes dans notre quotidien, à travers nos relations interpersonnelles, nos angoisses et nos loisirs. Et avec raison – après tout, c’est, littéralement, ce qui nous maintient en vie.
Tel que dépeint par les médias de l’information et du divertissement, notre consommation alimentaire actuelle est le maillon d’une chaine entraînant des enjeux de santé publique, le réchauffement de la planète ainsi que des inégalités sociales flagrantes.
Face à cet état de fait, les milieux universitaires des sciences humaines s’intéressent de plus en plus à la production et à la consommation alimentaire. Qu’il soit question du point de vue culturel ou communicationnel, en sociologie, en économie ou en gestion, les cours et les programmes se multiplient.
Food and Social Change
Gastronomie et société
L’environnement agroalimentaire
History of Sustainable Agriculture
Et j’en passe.
Parallèlement, nos gouvernements se penchent également sur la question. Une politique alimentaire nationale est prévue pour 2018, et Santé Canada concluait, en août 2017, le processus de consultations publiques en prévision d’un nouveau guide alimentaire. Au Québec, une politique bioalimentaire est prévue pour le printemps prochain.
Or, dans le cadre d’un baccalauréat en droit, au Québec, les questions alimentaires et agroalimentaires, manifestement de grande importance, ne sont pas abordées – et si elles le sont, trop peu.
Pourtant, des programmes en droit et politiques agroalimentaires existent déjà dans plusieurs facultés de droit en Europe et aux États-Unis. Abordant des questions de production agricole, d’économie, de santé publique et d’environnement, entres autres, ces programmes permettent à leurs étudiants de comprendre les impacts de la production et de la consommation alimentaire selon une approche systémique, tant nationale qu’internationale.
En tant que future juriste, je crois profondément que la pratique du droit participe activement à l’évolution de la société québécoise et canadienne, et permet de la rendre plus saine et plus équitable. J’emprunte les mots de Marion Nestle, experte en politiques alimentaires et professeure à l’Université de New York :
If we want to improve our food system, we need to know what has to change and how to make that change happen.
C’est tout simple. How to make that change happen. Le fameux « Comment?« . C’est à cette étape de la résolution du problème systémique de notre alimentation que se situe le professionnel du droit.
Nos facultés de droit ont la responsabilité de former non seulement les avocats de demain, mais des citoyens qui seront en mesure d’appréhender les réalités complexes de nos sociétés actuelles, et pourront être instigateurs de progrès social.
Pour moi, ce progrès débute les deux mains dans la terre, dans une ferme de région ou un jardin communautaire urbain, et se termine dans notre assiette, en passant par l’éducation, et le droit.
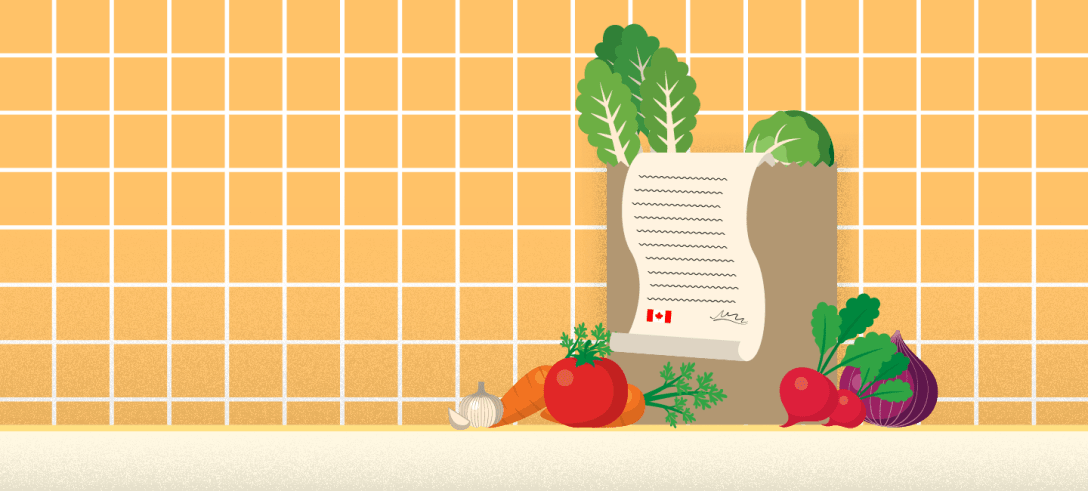
Merci Laurence! Ceci nous concerne tous. Longue et bonne vie au Bouffisme! On en a besoin.
J’aimeAimé par 1 personne
Excellente réflexion. Hâte de lire la suite.
J’aimeJ’aime
Très intéressant.
Une suggestion pour un prochain article: une réflexion posée et non-idéologique sur le dilemme manger de la viande versus la cruauté animale.
Merci
J’aimeJ’aime